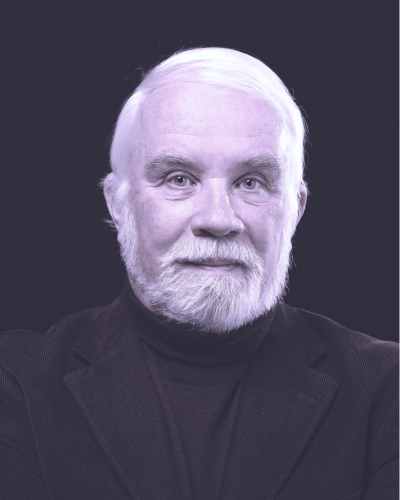Les éditions de l’Aire et Empreintes publient deux nouveaux ouvrages du poète Pierre–Alain Tâche. Fuguer et Changer d’Air évoquent, sous forme de récits de voyage et de poèmes, des perceptions du monde recueillies par l’auteur lors de ses voyages. Il répond à nos questions sur son rapport poétique au voyage.
Morgane Heine: Votre dernier ouvrage Changer d’air, publié aux éditions Empreintes, rassemble des poèmes inspirés par vos voyages. Vous évoquez l’Italie à travers la ville de Trieste, l’Écosse ou encore la Norvège. Par quoi votre regard est-il attiré lorsque vous voyagez dans ces lieux?
Pierre-Alain Tâche: Mon regard ne choisit pas. Ouvert à la sensation, il s’expose plus qu’il ne sollicite, s’exerçant à faire du réel une lecture incluant tout ce qui l’anime. Face à un paysage, il s’attache à la lumière qui le baigne, à la densité d’un arbre ou à l’harmonie d’un édifice et, dans un même élan, au sentiment qui naît de la rencontre. Le paysage implique ainsi l’entier de mon être face à sa complexité parce que, comme Michel Collot nous en avertit, il «est le lieu d’une expérience sensible qui associe l’intérieur et l’extérieur, le corps et l’esprit, le réel et l’imaginaire».
Tout se passe dans l’étroit focus d’un instant. Mon regard n’est pas vierge. Il porte en lui une part de ce qui m’a nourri, constitué. Mais il n’a pas d’attente et veut être surpris par la beauté d’une perspective, par la singularité d’un être, d’une scène, ou séduit par les jeux de formes, de lignes et de couleurs qui font l’inépuisable plasticité du monde, mais aussi bien celle du vivant. Il s’en remet volontiers au hasard des rencontres, au détail, à l’infime, à l’anecdotique. Il est sensible à la secrète tonalité des lieux. Il en recueille les signes et s’exerce à les relier entre eux, mais aussi à voir au-delà d’eux. Il renoue sans cesse avec le réel plus qu’il ne le recense.
M.H.: En quoi ce regard diffère-t-il de celui d’un voyageur ordinaire? En quoi la sensibilité à la poésie diffère-t-elle du récit de voyage en général?
P.-A. T.: Nous avons le monde à portée d’images, de beaucoup trop d’images. Le voyageur «ordinaire», à ce que j’ai pu observer, ne se met pas en jeu dans le regard. Il consomme et néglige d’envisager le réel dans sa dimension plurielle – ce qui incombe pourtant à qui veut voir et refuse ainsi de se contenter de regarder. Et, sans doute, n’en éprouve-t-il pas le besoin, car aller au-devant des représentations qu’il porte en lui pour les avoir phagocytées, dès avant son départ, les faisant siennes, lui suffit. Son regard documente, ainsi, plus qu’il ne participe. Il devient prise de vues par désir de capter ce qui lui fait face, mais que finalement il n’a pas pris le temps ou la peine de regarder vraiment. Et, ce faisant, il accumule plus qu’il ne sauvegarde, toujours en grand danger de perdre en fraîcheur, en ingénuité et, finalement, en liberté.
On me permettra de me situer à l’exact opposé de ce portrait outrancier. Pour tenter de ne pas tomber dans le travers qu’il stigmatise, je m’accommode d’une connaissance approximative, généralement assez floue, des destinations que j’ai choisies. J’aspire à découvrir une terra incognita. Voyager, en effet, n’est pas affaire de savoir, mais de perception et de sensibilité. (Voir, aussi.) Je m’accommode donc de mes maigres repères, espérant même en tirer parti. Si nécessaire, la prise d’informations se fera au retour pour préciser ce que j’ai perçu, pour l’enrichir et l’ouvrir à d’autres perspectives afin de donner une part de sens à ce que j’aurais vécu.
Mais l’essentiel reste ce que mon regard aura capté. La poésie aide à préserver cela, qui permet de maintenir l’aventure de voir et d’aller au-devant d’on ne sait quoi dans la lumière des instants du voyage. Le récit, quant à lui, aurait à rendre des comptes. Il se devrait d’être plus soucieux de précision, même si la mémoire et la subjectivité trahissent ou travestissent invariablement le vécu qu’il relate.
M. H.: Écrivez-vous lors de vos voyages ou après ceux-ci? Comment se déroule votre processus d’écriture?
P.-A. T.: Si le séjour dans un lieu du voyage permet parfois la rédaction d’un texte ou son ébauche, cela demeure toutefois l’exception pour ce qui est de la poésie. S’agissant d’elle, la pérégrination (à quoi se réduit volontiers le voyage, de nos jours) interdit généralement toute pratique d’écriture par manque de temps, de disponibilité ou, tout simplement, par fatigue. La notation sera donc essentiellement affaire de mémoire. Je me gorge de visions et de sensations, comme une éponge. Tout au plus m’arrive-t-il, en chemin, d’engranger dans un carnet une image, des mots épars et potentiellement sans relation entre eux ou même quelques vers dont je ne sais trop ce qu’ils tendent à saisir, mais dont je veux croire qu’ils contiennent la sève de mon vécu.
Le processus d’écriture est lent et long, qui peut intervenir des mois après le voyage et durer des années. Il y aura donc de nombreux états. Il s’agit, à chaque fois, de me resituer (ce qui n’est pas facile) dans le flux d’un instant passé qui a laissé trace. Pour en questionner l’intensité (plus que la justesse) et pour quêter ainsi, pas à pas, le sens encore indistinct de ce que j’ai vu, de ce que j’ai vécu. L’écriture du poème s’en remet alors à la subjectivité du moment tout en se fiant au potentiel expressif de la rencontre (qui ne peut jamais être évalué dans le temps de la perception). Elle est en quête et le demeure jusqu’au moment où le poème parvient à me surprendre. À défaut, il s’essouffle et risque fort de n’être pas. Car l’achèvement du poème ne peut être voulu: il doit tomber un jour comme un fruit mûr.
M. H.: Entre 1998 et 2011, vous aviez déjà publié trois ouvrages qui constituaient un «état des lieux» du monde, en quoi ce nouveau volume poursuit-il ce projet et en quoi s’en différencie-t-il?
P.-A. T.: Les trois volumes de l’État des lieux ont été conçus comme un recensement général. Ils ont questionné la relation au lieu pour constituer, en fin de compte, une trilogie. Laquelle correspond à une esthétique inscrite dans un espace-temps désormais clos, sinon prescrit. On se retrouve certes, avec Changer d’air, dans une même veine thématique, mais la perspective a évolué. Ce recueil poursuit donc le projet de l’État des lieux à sa manière, mais il s’en différencie en raison d’un changement de cap radical et d’une redéfinition de sa finalité. Il est, en effet, à lire, dans son déroulement qui se veut une lente et hasardeuse procession vers le nord (et vers tout ce que ce dernier renouvelle progressivement dans le questionnement par lent dépouillement, par l’expérience d’une solitude glacée hantée d’un infini silence). Si, pour faire la liaison, sa première partie, consacrée à Trieste, reprend encore la forme prévalant antérieurement, j’ai eu clairement dessein de faire progressivement évoluer cette dernière vers une plus grande économie. Le ton change aussi, qui finira par devenir méditatif et même, à la limite, teinté de préoccupations métaphysiques. À la contemplation d’un Spitzberg ô combien mystérieux.
M. H.: Un autre ouvrage, Fuguer, a été publié simultanément aux éditions de l’Aire. Pourquoi avoir choisi de publier ces ouvrages dans deux maisons d’édition distinctes?
P.-A. T.: Les deux maisons d’édition n’ont ni la même assise, ni la même vocation. Empreintes publie exclusivement de la poésie ou des textes en relation avec la poésie. L’Aire consacre certes une collection à cette dernière (à laquelle j’ai d’ailleurs été associé en son temps), mais je lui dois surtout la publication de l’ensemble de mes dernières proses. Fuguer, qui rassemble des récits de voyage, s’inscrit dans la continuité de cette aventure éditoriale. Aucun de mes éditeurs ne m’a jamais demandé de lui assurer l’exclusivité de ma production. Cela dit, L’Aire aurait-elle accepté de publier quasi simultanément les deux livres? Je n’en sais rien. Pour la bonne raison que j’avais promis ce nouveau recueil à Alain Rochat, qui a donné à lire l’essentiel de ma poésie.
M. H.: Cet ouvrage évoque également une envie de Changer d’air mais à la manière d’une «fugue». En quoi consiste cette fugue?
P.-A. T.: Le vrai voyageur est toujours en partance. Il fait place nette et s’en va sans vraiment savoir quand il reviendra. En cela, je ne suis pas, je n’ai jamais été un vrai voyageur.
La fugue est momentanée. Elle implique l’idée même du retour. Et c’est dans cet esprit que je conçois chaque départ, car, au fond, je suis un sédentaire, qui ne souffre pas de l’être. Si je ne me sens pas prisonnier de mon univers quotidien, je garde cependant une raisonnable curiosité pour l’ailleurs. La fugue est à l’exacte mesure de cette dernière. J’aime alors par-dessus tout faire l’entier du chemin d’un lieu à un autre. Ce qui, en principe, exclut l’avion. J’ai ainsi volontairement limité le rayon de mes escapades.
Une telle restriction peut surprendre. Pour l’essentiel, elle découle du temps compté qu’il m’a été loisible d’accorder au voyage. (Je ne suis jamais affranchi de la tutelle du retour.) Mais elle tient aussi au fait que j’ai toujours considéré mes déplacements dans l’espace comme une liberté que je m’accorde tout en sachant, dès le départ, qu’elle est limitée et provisoire. La parenthèse heureuse se refermera. Il m’a fallu apprendre à accepter cela, mais les dons de la fugue demeurent un privilège dont je mesure tout le prix. Cela dit, en route, je jouis sans réserve de l’exception que je m’accorde. Il reste que le plaisir que j’éprouve à voyager ne serait pas ce qu’il est si je ne gardais pas conscience de la précarité et de la rareté d’un état passager.
Propos échangés avec Morgane Heine par courrier électronique, décembre 2023