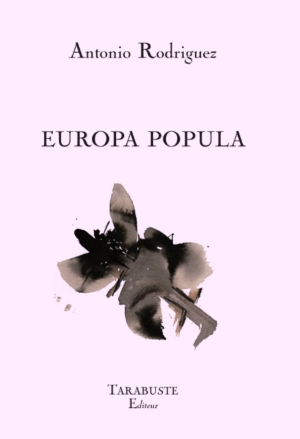La Fondation Pierrette Micheloud attribue son Prix de poésie 2021. Comme presque chaque année, elle salue un recueil qui s’est particulièrement distingué en 2020; par l’engagement poétique qu’il propose; par son originalité notamment. Cette année, le recueil primé revient à une figure bien connue du site: Antonio Rodriguez, son responsable. Il recevra le Prix Pierrette Micheloud pour Europa Popula (éditions Tarabuste, 2020), un ouvrage qui clôt sa trilogie sur l’Europe. Nous l’interrogeons sur son écriture, ce continent, avant la remise du prix le 13 décembre au cinéma Bellevaux à Lausanne.
Sandra Willhalm: Europa Popula (éditions Tarabuste, 2020) est le troisième volet d’une trilogie sur l’Europe. Pourquoi avoir choisi ce continent comme territoire poétique?
Antonio Rodriguez: L’Europe est pour moi un sol, une évidence. Ce sol est là, sous mes pieds, et je trouve nécessaire d’en faire un lieu poétique, par des actes, des mots, des poèmes, des réflexions, mon nom et ma langue. Nous vivons de grandes mutations, alors j’ai besoin de décrire les flux sur le continent, les foules (vivantes ou mortes), les nœuds de notre époque.
Comment faire «tenir ensemble» (c’est le sens étymologique du mot «continent») ce qui tient mal ensemble? Il ne s’agit pas de l’Union, qui est une tentative politique et historique pour bâtir cet ensemble, mais d’une manière de se tenir dans une trajectoire commune. J’avais seize ans lorsque le mur de Berlin est tombé, et nous étions une génération à croire en la réunification de l’Europe, en sa possibilité de surmonter les désastres accumulés. J’ai vu des mouvements forts contre le racisme, les discriminations en tout genre, notamment sexuelles. Nous étions porteurs d’un idéal, et maintenant que nous sommes dans la quarantaine, souvent dans des positions à responsabilités, nous parvenons mal à juguler les plaintes, les vieilles dominations et la violence. Il y a toujours cette menace et cette tentation de s’autodétruire.
J’ai commencé cette trilogie en 2007, par des poèmes parus dans le journal Le Courrier. Quelques dizaines de poèmes ont paru en revue et, en 2015, le premier volume est sorti. La montée du populisme avant la crise financière de 2008 était déjà marquante, et j’avais l’impression d’un mal chronique dont ce continent n’arriverait pas vraiment à sortir; la maladie remonte au XIXe siècle. Depuis 2005, la langue française porte en elle le «non», la négativité de la constitution du continent. Il est important que cette langue travaille poétiquement sur elle-même.
S.W.: Le continent prend une curieuse forme dans ce recueil. Comment le présenteriez-vous?
A.R.: Nous allons de chambre en chambre, d’une salle d’accouchement, avec une nativité lente, à une clinique dans laquelle nous pouvons mourir sans souffrance, avec l’aide de robots infirmiers. L’ensemble passe par des détachements permanents, comme si le continent était devenu un musée, avec des tableaux vivants de l’histoire, où nous sommes pris derrière le miroir des apparences. Mais, comme dans Big bang Europa, le dénouement est heureux, il y a une poussée vers une vallée lyrique au milieu du continent, une sorte de paysage originel, qui est le véritable endroit. C’est le lieu de l’écriture et de la vie face au cauchemar. Pourtant, tout du long, on entend déjà les bottes, les hymnes à la Joie Dure, les affiches qui traitent les uns de porcs, les autres de lâches, la petite musique d’antan qui revient, avec ceux qui ont peur, et se soumettent à la violence, en criant plus fort que les autres. C’est l’atmosphère du recueil, sa trajectoire.
S.W.: Outre ce continent qui porte la trilogie, quels sont les autres points de convergence entre les trois recueils?
A.R.: La forme avant tout: ce sont des poèmes en prose poétique, sans majuscules, avec des virgules; chacun étant autonome et pris dans un flux. Il y a aussi la musicalité, le souffle, le ton. Pour moi, ce trait est essentiel: il faut entendre la même musique, qui monte à trois reprises. Le dernier recueil possède un mode majeur, alors que le premier tient plus sur un mode mineur. Le deuxième part sur un chant de noces qui se fait chant des morts. L’architecture doit rester un peu insaisissable, mais la musique toujours là. On sait d’où ça sort, on sent la forge.
Sinon, il y a aussi la vie d’un couple, avec des «petits», et une généalogie prise dans la matière de l’histoire. Ce n’est pas autobiographique directement, mais symbolique (un envers du biographique), et j’aime bien créer le doute, alors je crée ce jeu. Tout cela tente de contenir une vague en tout cas, et tous ces personnages se mettent à retenir une porte qui grince et qui est prête à céder. Elle cède effectivement dans Popula. La vague populaire l’emporte et saccage. Elle brûle l’ensemble.
S.W.: Comment passe-t-on d’un recueil à l’autre?
A.R.: Chacun porte son énigme, son mystère et, je le crois, une description minutieuse des forces en présence. C’est le propre de la poésie pour moi: parvenir à donner l’indescriptible, sans le saisir, sans le nommer, simplement en déployant le geste et la conscience du geste. Chaque recueil est le geste qui laisse advenir ce que portent ma sensibilité, mon esprit, ma chair, ma trajectoire, en restant tendu comme un mystère à l’état mystère, mais rendu visible.
S.W.: Sur votre site (orphee-plomberie.com), vous mentionnez que le «premier volume était centré sur le présent; le deuxième, Après l’Union, s’appuie sur ce qu’il reste du passé, sur la matière qui a surmonté les débris et qui sert d’origine multiple à l’Europe contemporaine». Comment est traité le temps dans ce dernier volume?
A.R.: Il est centré sur l’avenir. Pas très loin des films de science-fiction parfois, que je crois très poétiques bien souvent. L’ouvrage se dirige vers la section «Rose Robot», où une machine devient la Dame de Pétrarque, de Dante; elle sort des laboratoires Botticelli. Le livre adopte une vision obscure, dystopique, dans laquelle l’élégie tend à célébrer le présent. En somme, Popula souligne que «nous allons tout perdre», et que nous nous souviendrons de l’aujourd’hui comme de jours heureux — alors sort une curieuse célébration, celle de l’envers, qui est au centre de ma démarche. Il me semble que c’est le propre de la vie, de la santé, des cycles. Nous respirons; c’est alors qu’il faut explorer l’envers de l’existence, sans se contenter de son endroit, sans attendre la maladie (parfois révélatrice). Pour moi, Popula est le livre des mutations, la trajectoire devient celle d’une décantation.
S.W.: Un des poèmes d’Europa Popula a été mis en vidéo (conduit à un clip) par le réalisateur Yannick Maron dans le cadre du projet Close Poetry . Avez-vous été surpris par la proposition cinématographique? Qu’avez-vous pensé du montage et de la mise en scène par rapport au sens et au mouvement de votre texte?
A.R.: Yannick a choisi mon texte parmi d’autres, il était anonymisé. Il y a vu aussitôt des images, du rythme. Je l’avais retravaillé pour inclure le cycle de Popula à partir d’une séquence. J’ai été surpris par la lecture du comédien, Edmond Vullioud: très neutre, assez rapide. Le tournage de nuit à Lausanne me semble bien vu, même si le poème se déroule au couchant sur les murs. Il ne s’agissait pas de l’illustrer. L’actrice se fond dans le paysage urbain, joue très bien avec la caméra, le regard, le rythme. J’aime l’évocation de corps à corps avec des bouts de lumière, comme si la mémoire était collée à ses bras, à son visage. C’est le sens du texte. Ils l’ont très bien saisi. Le piano crée une montée et une accélération, qui s’accordent au texte, et le montage en devient nerveux, plein d’intensité. Nous le diffuserons au format cinéma pour la soirée à Bellevaux lors de la remise du prix. Pour moi, ce projet montre ce qu’est une poésie transmédiale et non simplement une illustration filmée.
S.W.: Ce n’est pas la première fois que votre poésie passe d’un média à l’autre ou est créée sur d’autres supports. Lors de l’exposition Digital Lyric au Château de Morges en 2020, vous avez notamment participé à l’installation «Responsive Europa». Sur un écran biface, le mot «Europe» se transformait et prenait de nouveaux sens en anglais. Comment envisagez-vous la technologie et la poésie en Europe aujourd’hui?
A.R.: Le fabuleux typographe Demian Conrad m’avait convié à ce projet. Le travail était un peu fou pour une biennale de design, puis pour l’exposition Code/Poésie. Je voulais partir sur un faux générateur de textes, qui ferait des dérivations sur le mot «Europe» avec deux vidéoprojecteurs, puis le poème est né (Eu/Rope, New/Rope, New/Hope,…). Demian l’a tout de suite adopté. Nous avons conçu Responsive Europa comme un chant, un hymne silencieux à l’Europe, au moment du Brexit. L’anti-Ode à la joie de Beethoven/Schiller en quelque sorte. Cela explique pourquoi il est en anglais. Mais il n’y a pas de son. Nous assistons à une montée avec un refrain où éclatent les formes et les couleurs, avec les mots.
S.W.: Comme nous l’avons mentionné, Europa Popula clôt une série sur l’Europe. Sur quoi repartez-vous à la fin de ce cycle, et que souhaiteriez-vous que les lecteurs gardent de sa lecture?
A.R.: Il y a dans la trilogie trois marches poétiques qui mènent à une porte. Les marches de cette énergie se nomment explosion, union et transmutation. La porte est ouverte.