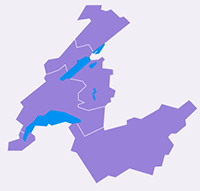Des questions sur l’esthétique, l’appartenance, les visées de la poésie sont posées à une quinzaine d’auteurs. 3000 signes environ sont accordés pour répondre.
enquête #1
1er septembre 2015
Ressentez-vous une appartenance poétique à la Suisse romande ?
Bien qu’elle vise une expérience largement partageable, chaque œuvre s’ancre dans un espace défini : culturel, linguistique, national, régional, cantonal, que ce soit par la production, la diffusion ou encore la réception. En tant que poète poursuivant votre œuvre en Suisse romande, vous sentez-vous pour autant un héritier, à un niveau ou à un autre, d’une certaine tradition poétique « romande » ? Par quel biais peut-on vous associer à la poésie romande – est-ce uniquement par le lieu de publication, votre résidence, votre lectorat majoritaire ou par une certaine esthétique ? Faut-il affirmer, au contraire, une identité française, francophone ou, désormais, plus globale ?
Réponses de : Olivier Beetschen, Laurent Cennamo, Pierre Chappuis, François Debluë, Patrice Duret, Claire Genoux, Vahé Godel, Claire Krähenbühl, Françoise Matthey, Cesare Mongodi, Alain Rochat, Pierre-Alain Tâche, Jean-Pierre Vallotton, Laurence Verrey, Mary-Laure Zoss.
Ces pages sont sous le copyright des auteurs : © Chaque auteur reste propriétaire de son texte. Merci de les contacter avant d’utiliser leurs propos.
Olivier BEETSCHEN
Suis-je l’héritier d’une tradition ? Non, bien sûr. La poésie naît toujours d’une rupture, d’une révolte, d’un désaccord profond avec le monde, qu’il soit réel ou littéraire. Edmond-Henri Crisinel, Georges Nicole, Jean-Pierre Schlunegger et quelques autres ont tiré de ce constat la conclusion fatale que l’on connaît. Blaise Cendrars, Nicolas Bouvier, Lorenzo Pestelli et quelques autres ont préféré claquer la porte, et partir affronter les bourrasques du grand large.
D’entrée de jeu, je me suis senti plus d’affinités avec les seconds. Pour autant, peut-on parler de filiation, d’influence, d’héritage ? À la réflexion, la réponse mérite d’être nuancée.
Mon premier poème digne de ce nom a été publié par la revue Digraphe, à Paris, dans les années 70. Intitulé Voyage à Celan, il a été écrit dans le sillage de la ruée hippie vers l’Orient. Beaucoup plus tard, avec le recul, j’ai cru pouvoir y déceler un modeste écho à la fois à la détestation du Sri Lanka exprimée dans Le Poisson-Scorpion, et à l’ivresse éprouvée pour la Belle amande dans Le Long Été . Au moment de l’écriture, je n’en avais nullement conscience. Mais aurais-je écrit le même texte, si je n’avais pas recelé au fond de moi la prosodie coléreuse de l’un, les malédictions envoûtantes de l’autre ?
Suis-je pour autant redevable à la seule poésie romande ? Non, bien sûr. J’ai été littéralement soulevé de terre, pour reprendre les termes du nomade de Cologny, à la lecture du poème Je me suis lavé, de nuit, dans la cour, d’Ossip Mandelstam. C’était dans les années 80, à une époque où il fallait du courage et de l’entêtement pour oser écrire un poème qui ne soit pas hermétique. Les acméistes russes allaient nous délivrer de nos carcans. Pour la même raison, j’accueillais chaque recueil de Jacques Réda comme une salutaire tornade qui, partie des bureaux feutrés de la NRF, crevait les barrages, dispersait les contraintes, essorait les mots d’ordre. Une fois les vannes ouvertes, tout pouvait arriver. Oserai-je, sur cette lancée, évoquer un Prix Nobel ? Accords et traces, du Suédois Thomas Tranströmer, m’ont procuré un sentiment de régénérescence nécessaire dans un temps où, la fatigue aidant, les mots commençaient à perdre séduction, sel et couleurs.
Faut-il, dès lors, affirmer une identité globale ? Surtout pas. La poésie ne doit rien affirmer du tout. Elle peut fissurer des certitudes, manifester des vertiges, interroger des gouffres. Si elle se met à brandir un étendard, elle perd sa raison d’être. Les exemples ne manquent pas de courants qui, se targuant d’être soutenus par une théorie, se sont fait phagocyter au point de disparaître, remplacés par ce qui devait les porter.
On me pardonnera, je l’espère, la forme négative de ces paragraphes. Ni ceci, ni cela. Voilà qui n’est pas commode. Mon attitude irrésolue ne vient pas de ce que je veux faire une réponse de Normand, ou de Vaudois. En fin de compte, pour creuser la question de l’ancrage dans un lieu, dans une culture, je me demande s’il n’est pas légitime de revenir à l’idée — ou est-ce un credo ? — que la poésie est consubstantielle à la vie. Et l’on sait que celle-ci se construit au gré des oscillations entre l’ici et l’ailleurs.
*
Laurent CENNAMO
Évoquant notre première rencontre quelques années plus tôt (vers l’an 2000), un ami se moquait déjà gentiment de moi, écrivant qu’alors je « jaccottet » déjà… Il y eut en effet (il y a toujours), Jaccottet, mais également Barthes et Kafka — si bien que je puis assez bien m’imaginer entrer à la fois dans les trois catégories que vous proposez, à la fois « suisse romand », « français » et « global ». Mais si Jaccottet n’était pas, à sa façon, une sorte de poète « global » ou universel, absolu ? Et Kafka n’est-il pas selon Deleuze le plus pur représentant d’une littérature dite « mineure », à la fois minuscule et infinie, déchirante ? Quant à Barthes, c’est Paris (le Paris rêvé des années 70, juste avant ma naissance, qui continue d’exercer sur moi sa fascination).
À vingt ans, c’est donc la découverte presque simultanée des œuvres de Roud, Crisinel, Jaccottet, Anne Perrier qui m’ont donné envie d’écrire de la poésie. Punaisés aux murs et étagères de la librairie du Rameau d’or à Genève où je finis toujours par « échouer », les photos de Jaccottet, Chappaz, Chessex, Roud m’attirent prodigieusement (je rêve peut-être vaguement, à la façon du petit Sartre dans Les mots, qu’un jour on me punaisera, moi aussi joli petit insecte sur cette étagère). Mais les librairies à Genève ne sont-elles pas aujourd’hui toutes plus ou moins mourantes (proximité cette fois menaçante de la frontière française) ?
Tirés de l’œuvre de Jaccottet, voici un échantillon de ce qui me fascinait (c’est-à-dire que j’avais envie de faire, ou de refaire, petit Don Quichotte en herbe) :
Un homme – ce hasard aérien,
plus grêle sous la foudre qu’insecte de verre et de tulle,
ce rocher de bonté grondeuse et de sourire (…) (Leçons)
Ou encore :
(…) À présent,
habille-toi d’une fourrure de soleil et sors
comme un chasseur contre le vent, franchis
comme une eau fraîche et rapide ta vie. (Chants d’en bas)
L’accent clairement est mis sur le lyrisme, c’est-à-dire une certaine longueur du vers (tendu, à la limite de l’éclatement), ainsi que sur la fluidité de la phrase (adorable, déchirant « enjambement » – qui me manque tant dans une certaine poésie contemporaine).
Ou alors, à l’autre bout (mais s’il n’y a pas dans le meilleur de la poésie suisse romande quelque chose de japonais, de chinois ?), des choses très courtes, lapidaires, proches du haïku – chez Anne Perrier par exemple :
La paix
Tu la tiens dans tes mains
Comme un melon d’eau (Feu les oiseaux)
Ce rapport complexe au paysage, aux origines, j’ai tenté de l’exprimer dans ces vers qui ouvrent mon premier livre :
Rideaux orange. Loin derrière, le M
majuscule de la Migros de Chêne-Bourg
au-dessus des grands arbres (plante étrange, toujours
immobile ou chapeau de femme que le vent jamais
ne fait s’envoler (…)
Arrivé en Suisse en 1966, mon père travailla durant 44 ans à la Migros (le M, donc, paradoxalement, c’est mon père). Quelqu’un (ignorant cela, bien sûr) me fit un jour la remarque suivante : un de ses amis français à qui il avait fait lire mon poème avait dû se faire expliquer ce qu’était cette « Migros » dont il était ici question. Ce quelqu’un alors de me conseiller de faire attention à ce genre de choses – mais alors quoi ? aurais-je dû écrire « Super U » ou « Intermarché », ou « Supermarket » pour être mieux entendu? C’eût alors été un autre paysage, donc une tout autre histoire, un autre poème (avec ma mère, chaque semaine, nous allions acheter de la viande sur France, et j’aimais beaucoup les panneaux publicitaires bariolés anarchiquement disposés au bord des routes, j’aimais que le bitume de ces mêmes bords de routes se décompose plus ou moins, se perde en menu gravillon, j’aimais enfin les sacs en plastique flottant dans les buissons, les branches poussiéreuses des noisetiers…).
*
Pierre CHAPPUIS
Excusez ma réponse tardive. Au vrai, votre enquête me laisse plus ou moins pantois. Ne serait-ce pas aux autres — vous par exemple — plutôt qu’à moi de tenter de me situer par rapport à ce qui, la poésie romande ou la notion de poésie romande, me semble à tout prendre une nébuleuse à laquelle, plus enclin à voir des différences et plus sensible aux qualités propres des oeuvres et de leurs auteurs, je n’aurai pas réfléchi d’une manière assez approfondie.
Concrètement, je me plais à le rappeler, c’est ici que, dès les années soixante, j’ai trouvé mes premiers appuis auprès de La Revue de Belles-Lettres, alors dirigée par Florian Rodari et Pierre-Alain Tâche. A partir de ce foyer toujours actif, de précieuses et durables amitiés se sont nouées assez tôt, favorisées par une présence commune à « La Dogana » sans qu’on puisse parler d’école ni de groupe mais, assurément, d’aspirations et de goûts souvent partagés.
Au demeurant, reconnaissance à tous ceux qui, éditeurs, lecteurs, critiques, contre vents et marées, luttent (parfois très solitairement) pour que les sources de la poésie, ici comme ailleurs, restent vives.
*
François DEBLUË
La question « régionale » m’intéresse peu ; celle de la langue beaucoup plus. Marguerite Yourcenar dit quelque part que sa vraie patrie, c’est la langue. Je l’éprouve de la même manière. Ma patrie, c’est la langue française. Et pour avoir étudié quelque peu le latin et le grec, je suis resté obstinément monoglotte…
Mon héritage, pour ce qui est de la langue poétique, me vient de Ronsard, La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire… Ponge ou Guillevic, par exemple, ce qui n’a rien d’original. Cela ne m’empêche pas d’estimer hautement Cendrars, Philippe Jaccottet ou Anne Perrier et d’autres de mes contemporains (désormais souvent plus jeunes que moi).
Je me méfie des clichés sur la poésie romande (ils ne manquent pas !). Ils naissent souvent d’une relative ignorance de la poésie française et de la poésie universelle. Ce qui est vrai, c’est que nos conditions historiques ne sont pas les mêmes, de sorte, par exemple, qu’il n’y a pas eu, à ma connaissance, de poèmes de la guerre dans la Suisse romande du XXe siècle.
En Suisse romande, nous avons peut-être échappé, depuis les années 1970, à un certain terrorisme du formalisme et à un certain intellectualisme tels qu’ils ont pu sévir en France. La poésie de Suisse romande n’a pas considéré le lyrisme comme suspect et condamnable.
Quant à savoir si l’on peut ou doit me relier à une esthétique romande, c’est aux autres de le dire. Je n’ai pas d’esthétique, pas de conception ni de concept préétablis de ma poésie pas plus que de la poésie en général. Ou alors, si je dois absolument en avoir, ils seront à chercher du côté du dernier en date de mes livres (Lyrisme et dissonance, éd. Empreintes, 2015), ou (sans doute) du côté des poèmes que je publie depuis une trentaine d’années…
Votre question s’achève sur l’idée de globalité. Elle rejoint, me semble-t-il, un rêve de la plus grande universalité possible que chacun poursuit. Dans une œuvre, quelle qu’elle soit, c’est ce qui dépasse les circonstances de temps et de lieu qui aura le plus de chance de durer un tant soit peu.
*
Patrice DURET
Je vais tâcher de répondre très personnellement à votre question (avec un grain d’impertinence), sachant qu’il y a eu, en ce qui me concerne, un revirement.
La poésie d’ici, porteuse d’intimité, de non-esbroufe, cache en en son sein un certain nombre de tourments. Pèse sur elle un couvercle.
Vue sous son aspect le plus caricatural, elle apparaît comme une poésie de la culpabilité, une poésie plaintive.
Le plomb de la tradition, le poids de l’air ?
Pas de réponse absolue, mais ceux qui habitent ici, en Suisse romande, ne peuvent pas ne pas en être imprégnés.
Encore faut-il y adhérer.
Je plaide coupable : j’y ai été évidemment sensible, évidemment impliqué.
D’une manière inconsciente, j’y ai souscrit – en tant qu’auteur, en tant qu’éditeur.
Mais un revirement a eu lieu ces dernières années. Une prise de conscience (tardive). Quelque chose n’allait pas, n’allait plus.
J’y étais attaché, je ne le suis plus.
Pour sortir de ce que je considère comme une impasse (une emprise ?) — cette forme minimaliste empêchée — j’ai commencé à chercher ailleurs1… ce que je cherchais, en vain, dans notre poésie : une vigueur, un ÉLAN.
1 dans les poésies américaines, grecques et belges, par exemple, ou la notion d’oser existe encore.
*
Claire GENOUX
Votre question surprend. Quand je suis en train d’écrire, je ne me pose aucune question d’identité, je ne ressens pas le besoin de me situer. J’écris ce qui m’habite. Que cela ait un lien avec une terre ou une quelconque tradition poétique. Ce n’est pas une préoccupation pour moi. Je suis même assez réfractaire à ce genre d’idée, comme celui d’une écriture féminine, par exemple.
Certes, je suis née à Lausanne et j’ai passé la plus grande partie de ma vie ici, mais je ne me sens pas appartenir à un lieu. Les lieux que j’habite sont plutôt intérieurs, comme celui de mon enfance ou ceux de mes voyages. Ils sont imaginaires. Je pars toujours de l’intérieur en écrivant. J’aime le pays, la ville et la région où j’habite, bien sûr, j’ai lu beaucoup les auteurs qu’on appelle romands, mais tout comme je lis des auteurs du monde entier. Le lieu de mon écriture, si je peux dire, n’a rien à voir avec un paysage particulier. J’écris justement pour la liberté de n’appartenir à aucun tiroir où l’on voudrait me ranger. Ce dont je suis sûre, c’est que j’aurais écrit, n’importe où, dans n’importe quelle langue. À mon avis, un écrivain ne doit pas se poser ce genre de questions, ça le fait sortir de ses préoccupations principales, c’est-à-dire le travail sur la langue. Le travail sur la langue n’est lié à aucun lieu, mais à une parole très intime, à un rythme, à une respiration.
C’est la solitude qui fait l’écriture plutôt qu’un lieu ou une tradition. C’est à partir de cette solitude qu’on écrit et c’est toujours sortir de soi. Les paysages qui nous entourent, les livres écrits ici ou ailleurs importent peu. Et le lieu n’est pas donné : il est à faire, au fur et à mesure des livres qui se déploient en nous. Et ils se déploient pour moi à partir d’un espace intérieur. C’est en tout cas comme ça que j’imagine mon travail. Écrire c’est pouvoir tout oublier de ce qui a été fait avant, c’est se réinventer. Écrire pour moi, c’est aussi créer un lien intime avec le lecteur qu’il soit vaudois ou qu’il vienne d’ailleurs. Et j’irai plus loin en disant qu’écrire, ça pourrait aussi être envahir l’espace d’autrui. L’écriture pour moi est transgressive ou elle n’est pas.
On est né d’un pays, certes, mais on est surtout né d’une enfance, avec son tissu de symboles, de quêtes, de secrets. La langue dans laquelle j’écris est ma langue maternelle. L’écriture est pour moi davantage une étreinte avec cette langue maternelle plutôt qu’avec un lieu, un paysage ou un pays, une culture, une esthétique suisse, française ou francophone. C’est un corps à corps avec la chair des mots dans lequel je m’enfonce avec un infini plaisir, que ce soit sous forme de poésie ou de prose, et cela revient exactement au même.
Je me suis éloignée peut-être de la question de départ, à laquelle je résiste, donc.
*
Vahé GODEL
Poète francophone, genevois, d’origine hybride… : une mère arménienne, née à Bursa, déportée avec les siens en 1915, à Konya…, avant de s’établir à Istanbul, où elle rencontra mon père, alors professeur au Lycée Galataseray… — mon père suisse, latiniste, linguiste, spécialiste des langues orientales, dont en particulier le turc et l’arménien…. Mes parents parlaient indifféremment le français, le turc et l’arménien. Ils mirent tout en œuvre (mon père surtout !) pour m’apprendre l’arménien. De cette langue, j’ai commencé à traduire des œuvres poétiques à peu près à l’époque où je griffonnais mes premiers poèmes : Le chant du pain de Daniel Varoujan (1884-1915) parut aux Éditions Seghers, en 1959, dans la collection « Autour du Monde ». C’est dire d’ores et déjà que je ne me sens guère comme l’ « héritier, à un niveau ou à un autre, d’une certaine tradition poétique romande »… Ma première plaquette de poèmes parut chez Seghers, en 1958 — et me valut le Prix « Étudiants du Monde », lequel me permit de me rendre à Prague, peu après l’intervention soviétique en Hongrie… (ce qui ne fut pas de nature à favoriser mon « intégration » !) Les séjours que je fis en Arménie soviétique dès 1969 — et surtout en 1973 — aggravèrent sensiblement mon cas… Le Groupe d’Olten, heureusement, n’allait pas tarder à voir le jour (1971) : plus de « röstigraben », je fraternisai avec Bichsel, Steiner, Marti, Eggimann…, et mon amitié avec Nicolas Bouvier ne fit dès lors que s’affermir ! Côté romand, j’eus le bonheur, dès mes débuts, de me lier avec quelques poètes remarquables (et donc tout à fait atypiques !) : Jean Hercourt (1912-1965), qui me révéla les grandes voix de la Négritude et de la Belle Province, Claude Aubert, Pericle Patochi (l’auteur de Pure Perte), — sans compter ma découverte de Werner Renfer. Ni, bien-sûr, le prodigieux, l’immense Blaise Cendrars ! Pour conclure, je citerai ce mot du poète anglais Nathaniel Tarn : « La poésie, c’est le bruit que je fais quand je suis le plus moi-même ».
*
Claire KRÄHENBÜHL
Cette sorte de regard en arrière peut réserver des surprises ou confirmer de vagues intuitions. Où me situer dans ce terroir et territoire romand ? Les réponses les plus évidentes concernent le lieu de l’écriture et celui de la publication. Par contre, la question de l’héritage me reste obscure.
Tenter un petit historique ? En 1976, après avoir passé cinq ans aux États-Unis, je me suis retrouvée un peu par hasard dans la région lémanique et c’est au cours d’une psychanalyse que j’ai écrit mes premiers poèmes publiés en 1982 chez Éliane Vernay (qui venait de créer à Genève, sa fameuse maison d’édition essentiellement vouée à la poésie). Deux autres recueils ont paru chez elle en 1985 et 1988. Ces textes ont donc été écrits à Vevey et publiés à Genève, mais se rattachent-ils à une certaine « tradition romande » ? Je cherche en vain une filiation : voix, thèmes, forme ? Ne trouve rien : ils auraient pu naître n’importe où. Mais, en suis-je si sûre ? Jeune fille, j’avais lu, grâce à ma sœur Denise Mützenberg qui était leur élève, l’œuvre de Jean-Pierre Schlunegger et même les tout premiers poèmes de Jacques Chessex (Une voix la nuit et Bataille dans l’air) ; ensuite, j’ai lu Roud, Jaccottet, Chappaz, Voisard et d’autres poètes d’ici (souvent découverts à travers la Revue Ecriture). Mais quand je survole superficiellement mes recueils, je ne vois aucune influence directe. Pas davantage celle d’Eluard, Bonnefoy ou Char, entre autres, que je lisais dans le même temps, ni celle de Rilke, Lorca, Neruda lus en traduction. Mon séjour aux USA m’avait permis de découvrir des poétesses féministes et engagées (c’était les Seventies !), par exemple Erica Jong, Adrienne Rich, Ann Sexton, et d’approfondir l’œuvre de Sylvia Plath, leur illustre aînée. Ces poétesses anglo-saxonnes ont-elles marqué mon écriture (nos cultures sont si différentes !) ? Peut-être par leur permission donnée d’oser dire ?
Toutes ces considérations composent une identité pour le moins floue !
Pourtant, fin 1986, m’installant à Rivaz après un nouveau séjour à New York, je fus surprise par une inspiration née sans aucun doute des retrouvailles avec ce paysage familier de lac, murs de vignes, cascade au pied du jardin, haies de prunelliers. Le titre même du recueil : « La rebuse de l’épine noire » avec ce mot rebuse typiquement vaudois, annonçait la couleur : ce livre-là je n’aurais pu l’écrire ailleurs !
*
Françoise MATTHEY
Otage privilégiée de deux pays, de trois cultures, née en Strasbourg, d’une mère suisse et d’un père alsacien, j’ai fait mienne la culture française de Montaigne à Proust, la culture germanique de Goethe à Thomas Mann et la culture helvétique de Ramuz à Jaccottet.
Et si je fus certes française jusqu’à mon installation en Suisse, je me suis toujours sentie faisant simplement partie de l’humanité, avec le Rhin et le Rhône près de moi tirant leurs verbes en pointillés sur les frontières.
Je n’écris pas comme une poétesse française, ni comme une poétesse suisse romande, il n’y a pas pour moi de poésie suisse romande mais une poésie en suisse romande, ou en France ou au Québec….
Ainsi le lieu où je vis me donne l’espace où donner libre cours à mes élans créateurs comme quelque chose d’antérieur à toute notion de racines. Je me sens d’ailleurs à l’étroit devant les conceptions d’appartenance à tel ou tel pays. C’est avec enthousiasme que très tôt dans ma vie j’ai appris à dire « nous » et « tu ».
Mon pays mental est donc celui de mon Alsace natale et de la Suisse romande qui a marqué à jamais ma conscience le jour où, très jeune, j’ai été séparée (pour un temps) de mes parents et suis venue vivre dans l’arc lémanique..
Ma trajectoire ensuite fut toute d’aller et de retours entre la France et la Suisse. Les tensions qui en découlèrent m’amenèrent à créer mon propre ici entre une terre sans cesse perdue et promise, deux mondes absents peut-être, à force d’être toute à la fois d’ici et de là-bas.
C’est sur cette désorientation du Verbe que se greffa très tôt pour moi la grâce de la poésie.
Aujourd’hui l’uniformisation du monde est en route. Plus que jamais avec la montée en puissance des intolérances, du matérialisme, les notions d’appartenance se font et se défont. Partout cependant des propos poétiques se crayonnent entre des écrivains de nationalités diverses, des artistes, des intellectuels, et je ne cesse de côtoyer avec eux, dans un esprit cosmopolite et universel, en filigrane et avec bonheur, nos âmes et nos racines dans un axe de collaboration, d’échanges et d’amitié qui ne peuvent se créer qu’au-delà de toutes frontières.
Loin des querelles de clocher des académies, je préfère à l’identité politique et nationale ou régionale ou cantonale, l’image éphémère d’un bulbe qui fleurit, que l’on peut déplacer et qui refleurit toujours, quelle que soit la terre où il s’enracinera pour un temps.
Je souhaite que le poète puisse, quel que soit le coin de pays d’où il écrit, garder la liberté d’écrire, les yeux ouverts sur le monde, et offrir dans son espace proche (penser global, agir local) un peu d’audace, la sensualité d’une poésie comme une aventure nécessaire, la profondeur d’une parole à l’écoute de mille bruits et silence inscrits dans une lumière possible.
Le rôle du poète est d’être et de rester inspiré, c’est-à-dire de matérialiser une intuition afin que les lecteurs en toute liberté puissent en profiter. Être publié en Suisse, comme je le suis, permet ce pas. Le contexte d’amitié, de respect, d’ouverture et de soutien dans lesquelles j’ai le privilège d’être éditée signifie autant d’encouragement à poursuivre mon travail sur les chemins mystérieux, difficiles et exigeants de la création. (Notez bien que les Éditions Empreinte qui me publient ne publient pas des auteurs, mais des textes).
Poétesse suisse ou poétesse française ? J’ignore comment je suis perçue mais je peux dire que pour moi les mots ne sont pas d’un pays, ils sont nous-mêmes, ils sont une attitude face à la vie, un courant, un souffle qui se moque des frontières, quelque chose en perpétuels mouvements et que j’ai le bonheur de pouvoir vivre grâce aux structures et fondations culturelles en Suisse romande.
*
Cesare MONGODI
La lecture des Fleurs du Mal, à l’âge de vingt ans, fut pour moi une révélation: elle m’amena à découvrir mon spleen dans l’univers de la finance qui constituait alors mon gagne-pain. Parti pour un voyage d’une année et demie en Orient, dans des librairies de Bangkok et Katmandou, j’ai trouvé des textes de Paul Valéry, André Gide, Georges Bataille que j’ai lus avec le sentiment qu’ils m’étaient « adressés ». Je crois que ma sensibilité poétique s’est d’abord forgée au contact de ces auteurs et de l’expérience du corps qui occupe une place prépondérante au cœur de leurs œuvres. Au cours de mes études de lettres, c’est un séminaire consacré aux poètes de la « présence », qui m’a fait connaître la poésie de Philippe Jaccottet avant d’être touché intimement par celle de P.-A. Jourdan. J’ai d’ailleurs rédigé mon travail de licence sur les relations qu’entretient sa poésie avec la tradition bouddhiste.
Cependant, malgré ma fascination pour l’écriture du paysage caractéristique des poètes de la « présence », c’est la poésie de l’épreuve intérieure d’Henri Michaux et d’Antoine Émaz qui m’a offert un tremplin vers ma propre voix. Le titre de mon premier recueil, « Pieds-de-biche », (rédigé au moment où j’entamais ma carrière dans l’enseignement et que je fondais une famille) évoque une parole poétique située dans les zones d’inconfort et de vulnérabilité: le travail, les conflits conjugaux, le poids du quotidien. La paternité et le retentissement de certains deuils qui y sont associés sont les sujets de mon deuxième livre « Ciao Papà » (écrit en français). Dans ces recueils, même s’il y a des vers libres (sans ponctuation), c’est en cherchant la densité textuelle du poème en prose que j’ai pu tisser entre les mots une tension en phase avec les sujets traités. Je pense que cette prédilection pour le poème en prose contribue à inscrire ma poésie dans le sillage des poètes nommés ci-dessus.
Ce rassurant sentiment d’appartenance à une tradition poétique est moins aigu depuis que j’écris dans ma langue maternelle, l’italien. L’influence de la poésie contemporaine italophone sur mon travail doit beaucoup à la lecture et à l’étude des poètes tessinois Giorgio Orelli et Fabio Pusterla (traducteur de Philippe Jaccottet et d’Antoine Émaz), mais j’avoue me sentir encore un peu « étranger » dans ma langue. En italien, pourtant, ma poésie peut exploiter des registres linguistiques (populaire, vulgaire, locutions) plus étendus qu’en français, ayant vécu jusqu’à mes dix-huit ans dans une région italophone. L’italien me permet par ailleurs d’entendre résonner des rythmes et des images du dialecte tessinois, au verbe rugueux et musclé, qui a été pour moi la première source de poésie. En relisant mes textes à haute voix, je perçois aussitôt et avec sûreté la puissante vibration charnelle inhérente aux rythmes et aux sonorités de l’italien. J’y trouve une incitation à explorer davantage la puissance expressive du vers libre et oser parfois le fragment (traits stylistiques qui m’apparaissent caractériser la poésie italophone). Je suis désormais curieux de découvrir les voies qu’empruntera mon écriture pour parvenir à formuler tout à la fois la tension et la convergence qui existent entre mon double héritage poétique francophone et italien.
*
Alain ROCHAT
Il fait jour
Il fait jour la poésie n’a pas
perdu son temps.
Alexandre Voisard
J’aime cette affirmation – ce cri d’allégresse – de Voisard ; affirmation du pouvoir inégalable du poème pour qui cherche un rapport lucide et véritable à la réalité du monde qui l’entoure.
C’est de cette nature profonde de la langue du poème que je suis, avant toutes autres considérations politico-sociologiques (au sens noble du terme).
Je devrais, pour bien faire, donner deux réponses, l’une comme poète, l’autre comme éditeur. On imagine bien que les choses sont différentes, d’une place à une autre, statut difficile, ambigu, et aujourd’hui il me semble que mon activité d’éditeur a enseveli ma pratique de l’écriture, que je tente pourtant périodiquement de réchauffer.
Il y a un double enracinement : l’un dans les œuvres aimées, lues, relues, méditées, l’autre, dans une réalité géographique, historique, sociologique. Elles ne s’opposent pas, mais s’ajoutent. Ainsi, d’un côté, Rimbaud, Éluard, Prévert, Guy Lévis Mano, St-John Perse, Voisard, Pache, Neruda, Lionel Ray, parmi tant d’autres, et de l’autre côté, un vaudois de souche, protestant, aimant son pays, et tous les autres, curieux du monde, ayant fait l’expérience de l’exil momentané dans des cultures radicalement différentes, passionné par toutes les questions de la vie en société, à quelque échelle que ce soit.
Comme auteur, mon espace est celui de mes lecteurs : j’en ai probablement trois en France, et quelques autres en Suisse romande… C’est donc bien là que je suis ancré : dans la langue française, en Suisse romande. Avec une demi-douzaine de poèmes traduits en allemand et en italien, deux en romanche… quelques-uns dans d’autres langues.
En tant qu’éditeur, la question est tout autre. Nous avons été amenés, sans plan préconçu, à éditer des auteurs que je lisais adolescent et jeune adulte : Chappaz, Voisard, Gaberel, Tâche, par exemple. Des auteurs qui étaient liés à Bertil Galland, dont on sait le rôle qu’il a joué dans cette question de la « littérature romande ». Cette question n’a jamais été la nôtre, je veux dire que François Rossel (le fondateur des Éditions Empreintes, en 1984) et moi-même n’en n’avons jamais débattu. C’est la réalité du lieu et du marché qui s’est imposée : nous aimions des auteurs d’ici, nous les vendions ici, et cela revêtait une forme d’évidence. Nous n’avions pas de lien avec des auteurs français, et ce n’est qu’au moment où nous avons été sollicités par certains d’entre eux que la question de les publier s’est posée : la réponse fut claire, non, parce que nous n’avions pas accès au marché français, faute de diffuseur et de distributeur efficaces.
Nous (Empreintes) avons bien le sentiment de perpétuer une tradition, celle du livre bien fait, du dialogue avec les peintres, tradition qui s’appuie sur un savoir-faire technique encore présent, plutôt que sur des critères esthétiques. Il y a en Suisse romande un public fidèle pour les livres de poèmes, parfois fervent, qui se renouvelle, me semble-t-il, autour des éditeurs en action.
*
Pierre-Alain TÂCHE
Qui écrit un jour ne saurait raisonnablement prétendre surgir de nulle part, hors de tout contexte littéraire. Il serait donc, de ma part, ridicule autant qu’injuste de nier une dette certaine envers les poètes d’ici (Roud, Jaccottet, Chappaz, Chessex) qui m’ont, en quelque sorte, confirmé dans ma vocation — avant de me témoigner leur confiance. Mais je dois aussi beaucoup à d’autres lectures, à d’autres rencontres, aux Reverdy, Supervielle, Frénaud, Tortel, Follain, Jouve, Oster, Gaspar, Réda, Bonnefoy (pour ne citer qu’eux !), qui m’ont ouvert à ma propre voie et qui, souvent, auront guidé ou, du moins, accompagné ma réflexion sur la poésie. Mon expérience, en ce sens, a toujours été celle de l’ouverture — et, par là même, transfrontalière.
Mes livres ont presque tous été publiés sur l’arc lémanique (Bertil Galland, L’Âge d’homme, Payot, Empreintes, Zoé). Ce fait n’a pas de portée particulière, sinon celle d’attirer l’attention sur l’exceptionnelle fécondité de l’édition romande. Un lectorat de proximité, pour l’essentiel, en est la conséquence — sauf à ajouter que de nombreuses publications en revues m’ont assuré une audience non négligeable en France, où mon travail d’écriture a d’ailleurs été distingué à plusieurs reprises.
Quant à l’existence ou non d’une « littérature romande », il s’agit d’une question qui, comme on sait, a longtemps agité les esprits. Elle les divisait, les uns se rangeant à l’avis de Jacques Mercanton pour affirmer qu’une telle entité n’existe pas « parce qu’une littérature se définit par la langue dans laquelle elle est écrite », les autres, avec Bertil Galland, prenant en compte « la durée, l’intensité, la qualité, l’originalité d’une relation entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent sur un territoire donné » pour affirmer l’existence d’« une vie des lettres qui possède sa propre échelle de valeurs ». Les temps ont changé et, avec eux, la manière d’envisager la chose. Roger Francillon, intitule « Histoire de la littérature en Suisse romande » la vaste et remarquable somme dont il aura dirigé la publication — et ce, dès sa première édition. La nuance est de taille : il s’agit de délimiter une aire d’observation, mais il n’est plus question de suggérer qu’elle puisse fonder des particularités identifiables ! Je ne vois d’ailleurs guère nos auteurs se préoccuper aujourd’hui d’une hiérarchie interne et se réclamer de « valeurs » partagées pour revendiquer un statut « romand ». C’est même tout le contraire : ils veulent être traités comme n’importe quel écrivain dont la langue est le français — qu’il soit d’ici ou d’ailleurs. Il faut plutôt tenter de tenir son rang dans le vaste concert de la francophonie et d’y obtenir (mais c’est une tout autre histoire) une reconnaissance qui soit exempte de complaisance ou, pire, de condescendance. Je ne fais pas exception sur ce point : pour eux comme pour moi, la préoccupation identitaire n’a plus cours — ce qui n’empêche nullement de se réclamer d’une appartenance. Et c’est ainsi que j’écris en français en Suisse romande. (Mais je dois avouer qu’il m’est arrivé, voici bien des années, d’envisager l’existence d’une littérature romande qui soit, en quelque sorte, spécifique à raison de certains thèmes récurrents.)
*
Jean-Pierre VALLOTTON
Les pieds dans le plat
(J’emprunte ce titre à René Crevel)
Faut-il être d’ici ou d’ailleurs ? De là-bas ou de nulle part ? « Pourquoi voulons-nous vivre en exil ? », se demandait Ion Caraion. Peut-être parce que le poète, par essence, cherche sans fin sa vraie patrie (qui ne peut être que sa langue).
Tout poète authentique, même si très fier de ses racines (et pourquoi pas ?), vise à l’universalité. Chimère, si l’on admet que l’œuvre d’un poète ne passe jamais, ou rarement, le seuil d’une autre langue (et c’est un traducteur de poésie qui vous le dit !). Je m’abstiendrai de citer le fameux adage italien pour ne pas froisser plus avant mes valeureux confrères dans cette tâche impossible et pourtant indispensable – ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qui va nous échapper tant que nous ne serons pas capables de lire dans toutes les langues du monde.
On parle souvent ici de la Romandie comme d’une terre fertile en poètes – mais quelle terre ne l’est pas ? Chaque pays, chaque région pourrait en dire autant – voire davantage. Autocélébration un peu douteuse alors ?
Edmond-Henri Crisinel.
Henri Roorda.
Jean-Pierre Schlunegger.
Francis Giauque.
Bernard Gander.
Vital Bender.
Georges Nicole.
Quel est ce mur des fusillés ?
Cette litanie muette ?
Quels liens entre ces sept personnes ?
Tous poètes romands du XXe siècle qui ont mis fin à leurs jours.
Terre à poètes, donc
(ou poètes à enterrer ?)
Comment Madame Marion Graf, grande spécialiste de la poésie et récupératrice de cadavres, comment ose-t-elle, dans Histoire de la littérature en Suisse romande (nouvelle édition de 2015), évoquer l’« exclusion irrémédiable » qui pesa sur Francis Giauque, alors que du vivant du poète je gage qu’elle n’aurait pas daigné abaisser ses yeux sur cet être ravagé. Quelle dérision !
Certes, il ne correspondait pas à l’image idéale que certains voudraient se faire du poète romand. Ordre et harmonie, et surtout pas de remise en doute de la sainte réalité, socialement ou métaphysiquement parlant.
Par ailleurs, toujours dans le même opus, dix pages sont consacrées à Anne Perrier par Madame Doris Jakubec, et pas même une ligne à Pierrette Micheloud (1915-2007). Est-ce équitable ? Peut-on raisonnablement accepter que quelqu’un qui a voué son existence à la poésie, dont l’œuvre importante a par ailleurs été largement reconnue (récompensée, notamment, par le prestigieux Prix Apollinaire à Paris et le Prix de consécration de l’État du Valais), soit purement et simplement ignoré?
De même quand Madame José-Flore Tappy publie chez Seghers une anthologie de la poésie romande et qu’elle n’y fait figurer, parmi les vivants, que les personnes appartenant à son propre cénacle (y compris elle-même), cela témoigne-t-il d’une grande honnêteté intellectuelle ? Ou juste d’une certaine étroitesse d’esprit ?
Si la poésie romande est ce bourbier, qui aurait envie d’en faire partie, sinon les fossoyeurs ?
*
Laurence VERREY
Être interrogée aujourd’hui sur ce qui, dans mon long compagnonnage avec l’écriture poétique, relève de choix conscients et ce qui passe à mon insu dans ma langue, par héritage invisible, est une question forte, et difficile. Le propre d’un héritage est que l’héritier le reçoit sans l’avoir recherché. Ainsi pour la poésie et ses ramifications cachées, il me paraît indéniable que je suis reliée de façon subtile et profonde à mes racines romandes, et que j’ai reçu de cette terre de poètes, à laquelle j’appartiens à part entière par mon origine vaudoise, un sens de la beauté, du silence et du tourment. Les pages de Schlunegger et de Crisinel, mais aussi l’oeuvre de Ramuz, de Gustave Roud, d’Anne Perrier ou de Voisard ont éveillé — et éveillent encore — des résonances, un accord immédiat.
Je n’ai jamais cessé de lire les poètes du monde entier. Non pour écarter le poids d’un héritage, mais pour m’agrandir, explorer de nouveaux langages. Parmi les lignes de forces auxquelles se rattache initialement ma voix poétique, je vois celle du lyrisme germanique, et celle du surréalisme. Il s’est agi de chercher ma veine personnelle, plus ou moins consciemment, dans la force de ces grands courants. J’ai appris à m’éloigner de la parole de certains poètes romands lorsque s’y exprimait une forme de mélancolie, liée à un paradis inaccessible, un rapport à la mort par trop complaisant. À m’en rapprocher pour célébrer une soif, l’exaltation du charnel. À porter en accord avec moi-même une légèreté, une jubilation, un questionnement métaphysique.
Aujourd’hui ? J’assume mon identité de poète romande, en quête de ma présence au monde, du visage humain, d’une langue juste, ouverte à l’universel.
Des questions surgissent : comment me situer face à l’intemporel — est-ce toujours une des caractéristiques de la poésie romande ? Quelle posture adopter face au monde contemporain ? Et que vais-je donner à voir au public ? Resterai-je ou non en conformité/ conformisme avec une certaine ligne ambiante, définie par quels critères ? Par la critique ? Celle-ci existe-t-elle réellement ? L’évolution actuelle d’une certaine poésie, qui tend à casser les termes de la langue et le sens même, à instaurer un matérialisme du langage, m’interpelle et souvent me déroute, me met en porte-à-faux. Un débat sur tous ces aspects me paraîtrait bienvenu. Pourquoi pas par le biais du site poesieromande ?
*
Mary-Laure ZOSS
Saisir la notion de « tradition poétique romande », distinguer clairement une unité culturelle dans la pluralité de ses voix me semble difficile, au sein d’une aire linguistique qui ne se distingue pas fondamentalement de la France.
J’éprouverais le même embarras s’il me fallait définir la « poésie française » contemporaine.
Cela dit, mon travail s’inscrit dans le réel où je vis, en particulier dans une géographie de montagne ou de moyenne montagne ; mais ces espaces peuvent être aussi bien le Valais que les routes du Kirghistan ou du Ladakh.
Si je n’ai jamais cessé de lire des poètes romands et d’en tirer une nourriture essentielle – Jaccottet, Roud, Chappuis, Ramuz, je n’ai pas le sentiment pour autant de marcher dans leurs pas.
Je leur dois une façon d’appréhender le réel, le développement d’une certaine relation au paysage, leur approche d’un sens alliée à une interrogation sur les limites du langage. Chacun à sa manière m’aide à mieux habiter le monde. Mais s’impose au même titre pour moi la lecture d’A. Du Bouchet, d’Y. Bonnefoy, ou de Jacques Dupin.
Peut-être devrais-je malgré tout m’attarder sur Ramuz ?
S’aventurer dans cet univers où personnages et lecteur éprouvent intimement la présence serrée du monde concret, affrontent sa clôture et sa rugosité, où s’élabore une langue qui « décloisonne les registres », pour reprendre l’expression de J. Meizoz1 et subvertit la hiérarchie des voix, transfère la langue parlée dans la langue écrite, constitue assurément une expérience de lecture fondatrice.
Sans doute sa pratique de la distorsion syntaxique au profit d’un mouvement travaillé par les ruptures a-t-elle joué un rôle dans ma recherche d’une écriture poétique basée avant tout sur le rythme, impliquant un corps à l’œuvre amené à frayer sa voie à travers les obstacles du monde.
Parmi les auteurs « romands » auxquels je reviens régulièrement, je pourrais citer Valère Novarina (franco-suisse), Philippe Rahmy, Jean-Marc Lovay ou Jacques Roman (français, publiant en Suisse) – mais qu’ont-ils à voir avec une « identité romande » ? Ils me semblent résister à toute idée de classification.
Chez Novarina, c’est l’entreprise portée au-delà de toute mesure de travailler le langage dans sa matérialité, de le faire parler à l’encontre de l’hégémonie de la « langue-signe », c’est la réinvention inouïe et euphorique d’une langue engageant le corps et le souffle qui me parle.
Et la part que j’ai à cœur de réserver à l’oralité ou à la voix dans mon écriture a de quoi puiser une respiration dans cette œuvre où jaillit à chaque instant l’énergie d’une parole inchoative, plurielle, comme électrisée par le croisement des langues et des patois.
Dans une tout autre tonalité, l’œuvre poétique de Ph. Rahmy (Mouvement par la fin, Un portrait de la douleur et Demeure le corps, Chant d’exécration) reste exemplaire à mes yeux : l’écriture y germe, violente et crue, du lieu même d’un corps disloqué, se laissant âprement travailler par la douleur ; là aussi, c’est la singularité d’une voix qui m’ébranle, son intransigeante pureté, sa phrase taillée dans le vif de la souffrance et qui frappe les mots jusqu’à l’insoutenable.
Me sollicitent plus particulièrement les textes qui ont la faculté de délocaliser le lecteur dans la langue, de bousculer ses habitudes de lecture ; qui l’invitent à s’ouvrir des sentiers dans l’épaisseur des mots, à revenir sur ses pas, à s’égarer souvent; qui lui laissent au demeurant le loisir de construire librement son parcours, de s’y retrouver peu à peu, comme on le fait pour s’orienter dans l’inextricable parfois de l’existence.
1 J. Meizoz, Ramuz. Un passager clandestin des Lettres françaises, Zoé, 1997